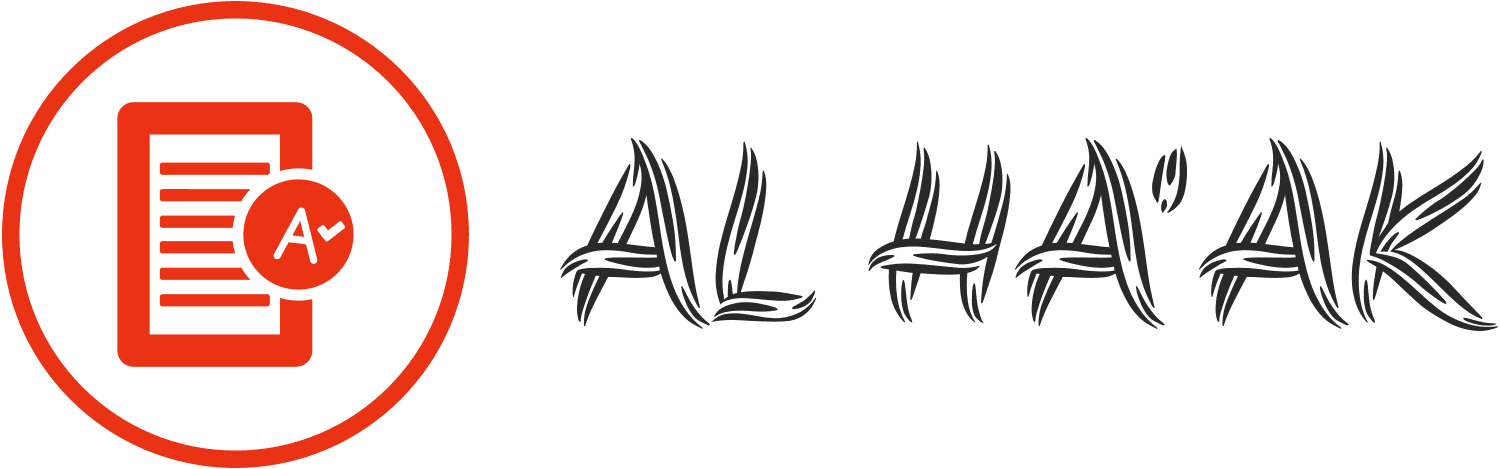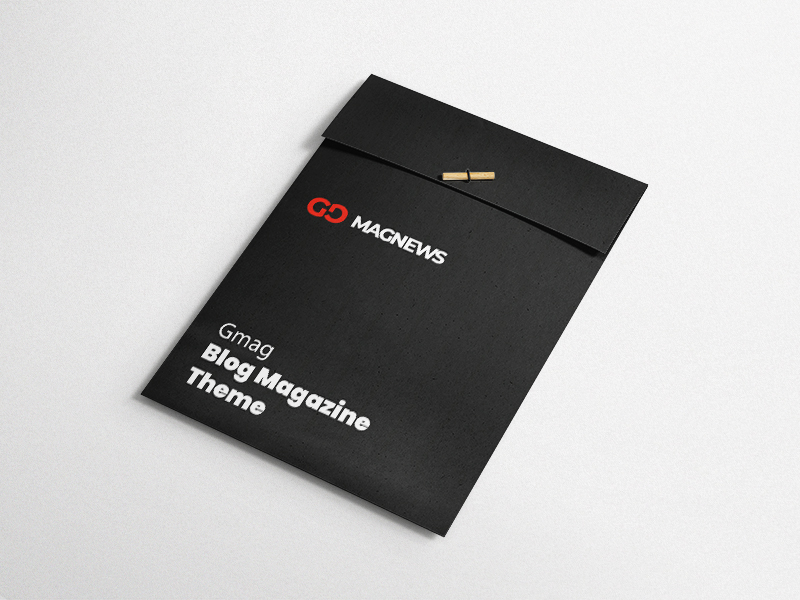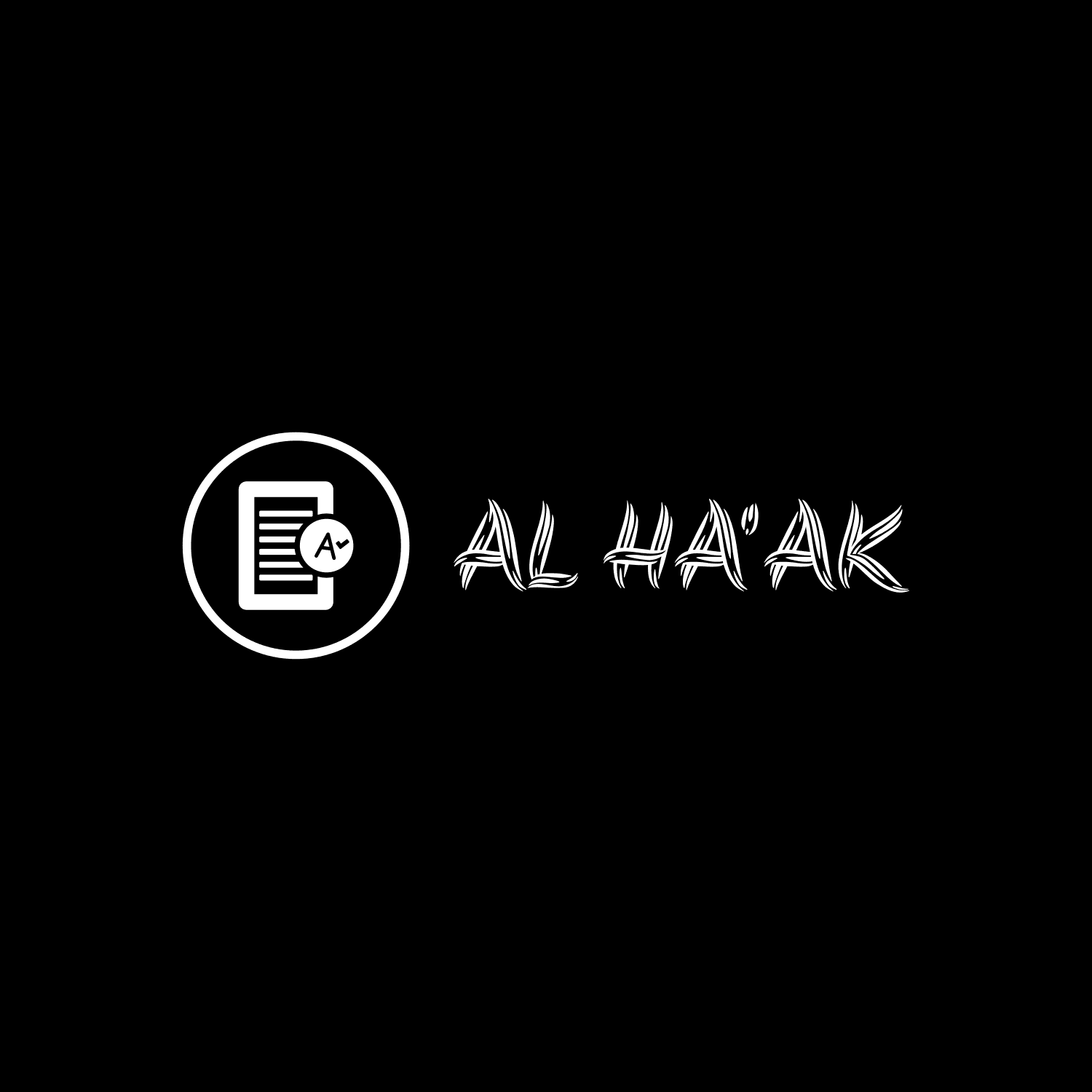Après avoir bousculé l'ordre régional en quittant la CEDEAO et la Francophonie, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) - le Burkina Faso, le Mali et le Niger - franchissent une nouvelle étape dans leur réorientation géopolitique en se désengageant de la Cour Pénale Internationale (CPI). Cette décision, lourde de sens, pose des questions fondamentales sur la justice internationale, la souveraineté nationale et les dynamiques de pouvoir en Afrique de l'Ouest.
Ce retrait n'est pas une surprise. Il s'inscrit dans la continuité d'une politique de "souverainisme" affichée par les régimes militaires au pouvoir dans ces trois pays. La CEDEAO, perçue comme un instrument de la diplomatie occidentale, a été la première cible de cette rupture. La Francophonie, symbole de la tutelle française, a suivi le même chemin. La CPI, quant à elle, est depuis longtemps critiquée en Afrique pour son supposé "deux poids, deux mesures". Accusée de ne cibler que les dirigeants africains tout en épargnant les puissances occidentales, elle est souvent perçue comme un outil de "justice des vainqueurs" plutôt qu'une institution impartiale.
Pour les leaders de l'AES, la CPI incarne cette ingérence étrangère dans les affaires intérieures. Dans un contexte de lutte contre les groupes armés terroristes et de construction de nouveaux régimes politiques, la menace d'enquêtes ou de poursuites de la part d'une juridiction internationale est vue comme une épée de Damoclès qui entrave leur action et sape leur légitimité. Le retrait de la CPI permet ainsi de s'affranchir d'une contrainte juridique extérieure et de renforcer la mainmise sur le récit de la "guerre" en cours.
La souveraineté contre la justice ?
Ce désengagement soulève toutefois de sérieuses questions éthiques et pratiques. En se retirant de la CPI, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se soustraient à l'examen de la communauté internationale en matière de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Bien que ces pays disposent en théorie de leurs propres juridictions pour juger de tels crimes, la faiblesse de leurs systèmes judiciaires et le manque de ressources et d'indépendance soulèvent de sérieux doutes quant à leur capacité à assurer une justice crédible et équitable pour les victimes.
La décision de l'AES pourrait également être interprétée comme un signal envoyé à la communauté internationale et aux populations civiles : celui que la justice pour les crimes les plus graves n'est plus une priorité. Dans un contexte de violences extrêmes et de violations des droits de l'homme, ce retrait pourrait potentiellement créer un climat d'impunité, ouvrant la voie à de nouvelles exactions.
Le retrait des pays de l'AES de la CPI n'est pas un acte isolé. Il s'inscrit dans un mouvement plus large de contestation de l'ordre international établi, marqué par la montée en puissance de blocs régionaux et la recherche de nouveaux partenaires stratégiques. En tournant le dos aux institutions de gouvernance mondiale, les pays du Sahel affirment leur volonté de se frayer un chemin en dehors des schémas traditionnels et de revendiquer une pleine souveraineté dans leurs choix politiques et sécuritaires.
Pour la CPI, le retrait de trois États membres est un coup dur. Il fragilise son universalité et son autorité, et confirme le fossé qui se creuse entre la Cour et une partie du continent africain. Dans un monde de plus en plus multipolaire, la question de la pertinence et de la légitimité des institutions de justice internationale se pose avec une acuité nouvelle. Le cas de l'AES n'est peut-être que le prélude à d'autres défections, et un avertissement que les dynamiques de pouvoir se reconfigurent, au détriment de l'idéal de justice universelle.