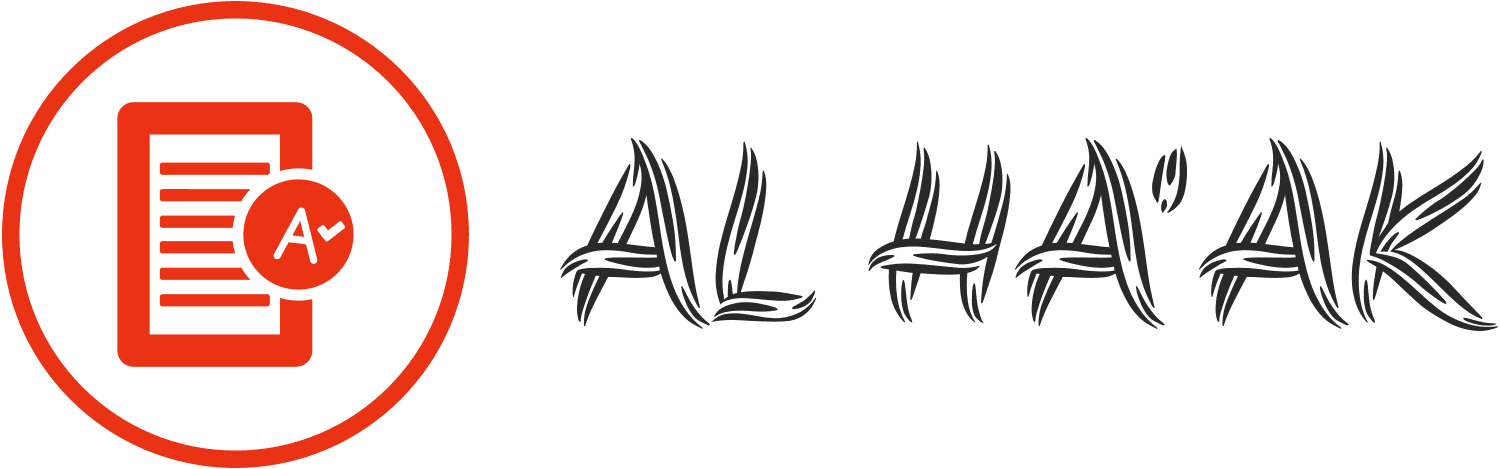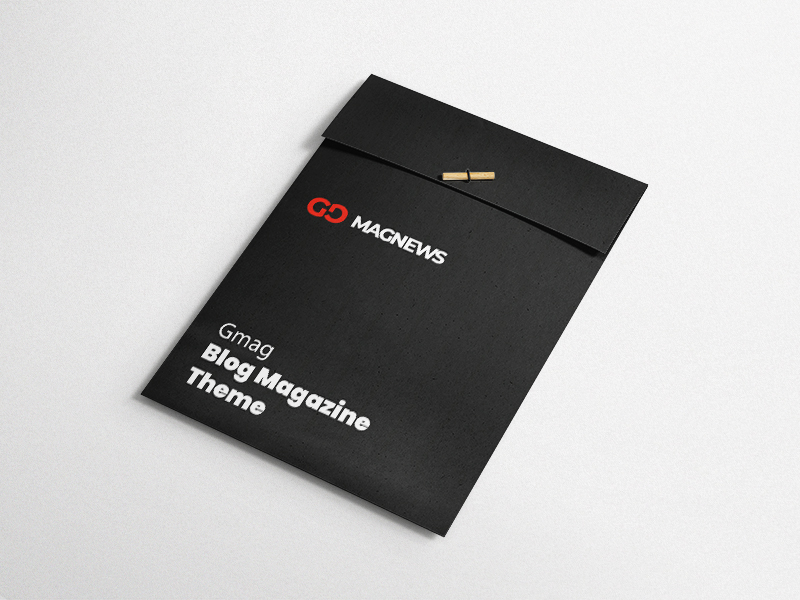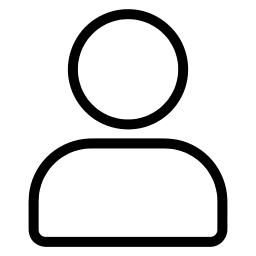N’Djamena, 4 septembre 2025 — En mission au Tchad du 1er au 4 septembre 2025, une délégation de l’Union européenne a été reçue à l’état-major de l’armée de l’air. Cette visite s’inscrit dans les réflexions en cours sur l’engagement européen au Sahel et, plus spécifiquement, sur la coopération avec le Tchad dans les domaines de la sécurité et de la défense.
Au cœur des échanges : l’engagement des forces tchadiennes dans la sécurisation et la stabilisation de la sous-région, ainsi que la place de l’armée de l’air dans cette chaîne opérationnelle. Les discussions ont mis en relief l’appui aérien et les missions civilo-militaires menées par l’armée de l’air, considérées comme des leviers déterminants pour la protection des populations, l’appui logistique aux opérations au sol et la réponse rapide en zones difficiles d’accès.
Selon les éléments partagés à l’issue de la rencontre, la délégation européenne a pu prendre la mesure du rôle central joué par l’institution militaire tchadienne dans l’architecture sécuritaire sahélienne. Les entretiens ont également permis d’identifier les défis auxquels les forces de défense et de sécurité font face : étendue du territoire, pression opérationnelle, besoins capacitaires et coordination inter-armées, autant de paramètres qui conditionnent l’efficacité des dispositifs de lutte contre les menaces transnationales.
Cette séquence de travail s’inscrit dans une dynamique de concertation technique, l’UE cherchant à adapter ses partenariats aux réalités du terrain et aux priorités nationales. Côté tchadien, l’accent mis sur les missions civilo-militaires traduit la volonté de l’armée de l’air d’ancrer l’action sécuritaire dans un continuum qui va de la protection aux services à la population, afin de consolider les gains de stabilisation.
Sans dévoiler de feuille de route publique, les deux parties ont souligné l’importance d’une compréhension partagée des besoins et d’un calibrage fin des appuis à venir. La visite aura, au minimum, posé les bases d’un dialogue opérationnel resserré entre N’Djamena et ses partenaires européens, dans un contexte régional où l’agilité et la complémentarité des réponses demeurent essentielles.